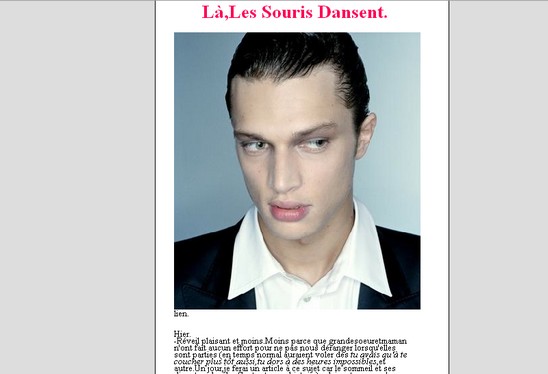Jeudi 9 août 2007 à 23:14

Elle sentait que ses sens lui faisaient peu à peu défaut. BientÎt elle se retrouverait comme portée à nue devant cet homme dont elle ne savait, au final, pas grand chose.
D'ordinaire elle détestait ce sentiment de vulnérabilité, il lui était autant insupportable qu'il était pour les autres inconçevable à son propos. En effet, comme briser une carapace comme la sienne ? Comment faire paraßtre fragile celle qui les mettait tous à terre ? D'aucune maniÚre.
A croire qu'il n'était pas les autres, et que l'ordinaire ne valait plus grand chose en ces temps aux sentiments troublés. Et cette croyance était bien plus proche de la vérité qu'elle ne l'aurait voulue. En son ùme et conscience elle savait, elle sentait son coeur chavirer, elle pouvait prévoir que bientÎt il ne lui appartiendrait plus.
Cette voie, sa voie, semblait sans issue."Chaque victime devient un jour bourreau" et c'est alors que le bien peut lui paraĂźtre le mal parce qu'elle n' aurait pas pensĂ© auparavant que ce qu'elle semait avec tant de cynisme, d'arrogance et de mĂ©pris puisse ĂȘtre un jour bĂ©nĂ©fique. Au lieu de voir l'amour elle voyait la haine et la faiblesse, et, loin de comprendre qu'il fallait se laisser vaincre, elle s'acharnait de plus belle, se raidissant et jouant l'indiffĂ©rence.
Les signes, pourtant, ne trompaient pas, et elle-mĂȘme ne pourrait s'ignorer longtemps encore.
On lui offrait des ailes et elle ne pouvait les considérer autrement que comme un poid supplémentaire. C'est ainsi qu'elle coula.
Jeudi 9 août 2007 à 15:19
Jeudi 9 août 2007 à 15:11
What if there was no light?
Nothing wrong, nothing right?
What if there was no time?
And no reason or rhyme?
What if you should decide?
That you don't want me there by your side?
That you don't want me there in your life?
What if I got it wrong?
And no poem or song?
Could put right what I got wrong?
Or make you feel I belong?
What if you should decide?
That you don't want me there by your side?
That you don't want me there in your life?
Oooh, that's right
Let's take a break, try to put it aside
Oooh, that's right
I can't ignore it if you won't even try
Oooh, that's right
When every step that you take
Can be your biggest mistake
And it could bend or it could break
Well that's just the risk that you take
What if you should decide?
That you don't want me there by your side?
That you don't want me there in your life?
Oooh, that's right
Let's take a break, try to put it aside
Oooh, that's right
You know that diamonds are reflective to light
Oooh, that's right.
Jeudi 9 août 2007 à 13:55
Il faut dire que, jadis, les livres Ă©taient beaucoup plus sensuels qu'aujourd'hui : il y avait largement de quoi sentir, caresser et toucher. Certains avaient une couverture en cuir odorante, un peu rugueuse, gravĂ©e en lettres d'or, qui vous donnait la chair de poule, comme si l'on avait effleurĂ© quelque cbose d'intime et d'inaccessible qui se hĂ©rissait et frissonnait au contact des doigts. D'autres possĂ©daient une jaquette en carte recouverte de toile au parfum de colle trĂšs Ă©rotique. Chaque livre avait son odeur propre, mystĂ©rieuse et excitante. Et lorsque la jaquette de toile bĂąillait, telle une jupe impudique, on avait toutes les peines du monde Ă se retenir de loucher sur l'interstice entre le corps et le vĂȘtement et s'enivrer des effluves qui s'en exhalaient. Mon pĂšre rentrait gĂ©nĂ©ralement une ou deux heures plus tard, sans les livres, les bras chargĂ©s de sacs en papier kraft dĂ©bordant de pain, d'oeufs, de fromage, parfois mĂȘme de corned-beef. Mais il arrivait qu'il revienne du sacreifice dans une Ă©tat euphorique, souriant d'une oreille Ă l'autre, sans ses bouquins bien-aimĂ©s mais Ă©galement sans nourriture : aussitĂŽt vendus il s'Ă©tait empressĂ© de les remplacer, car il avait trouvĂ© chez le bouquinite des trĂ©sors comme l'on en rencontre peut-ĂȘtre qu'une seule fois dans sa vie, et il n'avait pas pu rĂ©sister. Maman lui pardonnait, et moi aussi, d'autant que je n'aimais pratiquement que le maĂŻs et les glaces. Je dĂ©testais les omelettes et la viande en conserve. En fait, je crois bien que j'enviais les petits Indiens qui mouraient de faim et que personne n'obligeait jamais Ă finir leur assiette.
Le plus beau jour de ma vie - je devais avoir six ans - fut celui oĂč papa me fit un peu de place sur l'une de ses Ă©tagĂšres pour y ranger mes livres.
Disons qu'il me lĂ©gua quelque trente centimĂštres reprĂ©sentant le quart du rayonnage du bas. Je rĂ©unis tous mes livres qui, jusque lĂ , s'empilaient sur un tabouret prĂšs de mon lot, et les transportai Ă la bibliothĂšque paternelle oĂč je les disposais Ă la verticale, comme il se doit : le dos vers l'extĂ©rieur et la tranche contre le mur.
Traduit de l'israélien par Sylvie Cohen
Amos Oz, né à Jérusalem en 1939, vit à Arad, à la lisiÚre du désert du Néguev. Son oeuvre est traduite en trente-cinq langues et a recçu de nombreuses distinctions et prix littéraires.
Ce texte est extrait d'une roman autobiographique paru en février 2004, Une histoire d'amour et de ténÚbres (Gallimard, collection "Du monde entier")
Jeudi 9 août 2007 à 13:41
Et merci Ă l'
Ă©charpe au vent pour ce commentaire qui traĂźnait encore dans mes fichiers textes...
Again il s'Ă©coute
d'abord par sa phase crescendo, son petit solo de guitare, ses sons énervés,
puis son orgue lancinant aux environ de 9'42, pour terminer sur une déferlante
émotionnelle, et la voix de Craig Walker sidérante, qui arrache des larmes
depuis le plus profonds des entrailles, la cascade des instruments qui partent
tous en mĂȘme temps, la violence mĂȘme de... l'amour, oui c'est ça, tout ça qui
part... C'est un morceau incroyable, pour qui a le temps de l'Ă©couter, pour qui
est prĂȘt Ă sacrifier un quart d'heure de sa vie pour comprendre ce que signifie
le mot souffrance.
Car c'est ça Archive : une cinquantaine de morceaux, une cinquantaine de moyens
pour dire "j'ai mal".
Comment voulez-vous
ensuite poster un article pour dire ce que l'on pense d'Archive ? Si les
lecteurs s'en chargent pour moi dans les commentaires, s'ils me devancent...
Nan mais je vais finir par fermer moi !
Je ne sais pas oĂč va le
monde mais de ce cÎté-là ça me plait bien je dois dire.
Jeudi 9 août 2007 à 13:38
« En
mĂȘme temps AoĂ»t 2007 ne peut pas pire que AoĂ»t 2006. »
⊠Ca c'est toujours à voir.
Jeudi 9 août 2007 à 9:20
De petits Ă©claircissements s'imposent :
1°) quand je poste un article dans la catĂ©gorie VouZĂ©moi, vous ĂȘtes priĂ©s d'aller le lire avant de me laisser un quelconque messagedĂ©sobligeant.
2°) Je ne ressens aucune amertume concernant ma "dégringolade" du top 10. Petit rappel, à 15 ans je suis arrivée comme 3Úme blogueuse la plus visitée sur une plate-forme qui gÚre 171394 blogs à l'heure actuelle, et je reste 12Úme. Je trouve que c'est une jolie performance et je n'en demande pas plus.
3°) Avec mon passage à vide ces derniers temps seules les personnes appréciant réellement ce que je peux faire sont restées et ça n'est pour moi qu'un grand sujet de contentement.
4°) Je ne remercierais jamais assez les personnes qui postent pour moi.
5°) Ce blog fĂȘtera son deuxiĂšme anniversaire le 18 dĂ©cembre prochain et je pense avoir Ă©voluĂ© dans ma maniĂšre de faire. Si cela ne vous plaĂźt pas, je rĂ©pĂšte : je n'ai jamais forcĂ© personne Ă me lire !
Mercredi 8 août 2007 à 23:36
"You have a nice smile"
En fait j'en demande pas beaucoup. Son sourire dĂ©jĂ me suffit amplement, savoir qu'il m'est adressĂ© me ravit et le reste est sans importance. Il y des regards qui sont ainsi, qui mettent en confiance, qui vous donnent envie de rester lĂ oĂč vous ĂȘtes. Des regards qui rendent belle, des regards qui font que l'on se sent bien, sans raison aucune, si ce n'est celle la, un peu stupide, de ces deux yeux posĂ©s sur vous.
Qu'importent alors les erreurs et les faux-chemins ?
Rien. Rien encore. Et j' espĂšre, presque malgrĂ© moi que cela continue de la mĂȘme façon.
Mais stoppe ici ! Vite vite, arrĂȘte la machine, enraye tout, coupe les moteurs ! Dans quoi es-tu encore en train de t'embarquer ? Tu crains l'avenir parce que le prĂ©sent est agrĂ©able, tu as mille fois raison. Cela ira de complications en complications, tu ne sais pas faire l'intense et le simple Ă la fois.
La seule chose simple avec toi c'est la haine, et tu es incapable de l'éprouver. C'est révélateur alors tu ne veux pas ouvrir les yeux. Les tiens d'yeux, oui, les tiens. Pas ceux des autres, pas de banals miroirs. On voit ce que l'on se sent capable de regarder, un point c'est tout.
Je cherche déjà l'extrapolation possible.
Mercredi 8 août 2007 à 18:14
Des livres, on en avait Ă profusion, les murs en Ă©taient tapissĂ©s, dans le couloir, la cuisine, l'entrĂ©e, sur les rebords des fenĂȘtres, que-sais-je-encore ? Il y en avait des milliers, dans tous les coins de la maison. On aurait dit que les gens allaient et venait, naissaient et mourait, mais que les livres Ă©taient Ă©ternels. Enfant, j'espĂ©rais devenir un livre quand je serais grand. Pas un Ă©crivain, un livre : les hommes se font tuer comme des fourmis. Les Ă©crivains aussi. Mais un livre, mĂȘme si on le dĂ©truisait mĂ©thodiquement, il en subsisterait toujours quelque part un exemplaire qui ressusciterait sur une Ă©tagĂšre, au fond d'un rayonnage dans quelque bibliothĂšque perdue, Ă Reykjavik, Valladolid ou Vancouver. Lorsque - et cela s'Ă©tait produit Ă deux ou trois reprises - il n'y avait pas assez d'argent pour prĂ©parer le sabbat, ma mĂšre regardait mon pĂšre qui, comprenant que le moment Ă©tait venu de choisir l'agneau du sacrifice, se dirigeait vers la bibliothĂšque : en homme de principes, il Ă©tait conscient que le pain venait avant les livres et que le bien de son enfant l'emportait sur tout le reste. Je me rappelle son dos voĂ»tĂ© quand, franchissant la porte avec trois ou quatre de ses chers volumes sous le bras, il se rendait tristement Ă la boutique de M.Mayer pour lui vendre quelques prĂ©cieux ouvrages - on aurait dit qu'il taillait dans le vif. Abraham, notre pĂšre, devait avoir cet air-lĂ en quittant sa tente, Ă l'aube, portant Isaac sur son dos, en route vers le mont Moriah.
Je devinais son chagrin : mon pĂšre entretenait un rapport charnel avec les livres. Il aimait les manipuler, les palper, les caresser, les sentir. C'Ă©tait une vĂ©ritable obsession, il ne pouvait s'empĂȘcher de les toucher, mĂȘme si c'Ă©taient ceux des autres.
Mercredi 8 août 2007 à 16:52
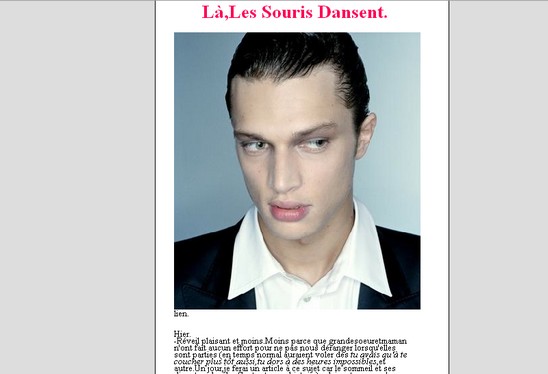
ChĂȘtive, avec l'accent. Un blog Ă aimer.
Mercredi 8 août 2007 à 16:36
 Qui ne tente rien n'a rien.
Qui ne tente rien n'a rien. Mercredi 8 août 2007 à 13:37

Et elles avaient parcouru la ville. En marchant, en courant, en sautant dans les flaques, parfois. Et elles en avaient maintenant la poitrine dĂ©chirĂ©e, de se dire que ce n'Ă©tait pas Leur ville, mais une parmis tant d'autres, une qui s'effacera avec le reste, parce qu'elles n'en sont pas dignes. Parce qu'elles ont une vie par ailleurs et que cette vie lĂ prend de la place. Elle en arrive Ă empiĂ©ter sur la place qui Ă©tait rĂ©servĂ©e aux rĂȘves. La place oĂč elles voulaient justement ranger cette journĂ©e, justement, c'est le mot. C'est inacceptable qu'elle s'efface, elles ne peuvent pas laisser ça arriver. Non, elles ne peuvent pas. Alors vont essayer, mais on ne se contrĂŽle jamais entiĂšrement. Au final, c'est ça, qu'elles ont peut-ĂȘtre voulu oublier. Maintenant elles ne sont plus que deux jeunes femmes fatiguĂ©es, fatiguĂ©es d'avoir voulu.
Merci Ă
faute.aux.graphiques pour la trĂšs jolie photo.
Mardi 7 août 2007 à 22:17
ELLE EXISTE AILLEURS. ET CA SOULAGE.
Mardi 7 août 2007 à 22:11
Se
réfugier dans les bras de quelqu'un. C'est aussi entrer dans son univers. Se
laisser border par les vagues qui caressent la coque de son navire. Ouais comme
une douce berceuse qui vous laisserait rĂȘveur. Il y a des bras maigres,
d'autres forts, des longs, des petits. Mais tous ont leur histoire, leur
sensibilité. Chacun sa maniÚre d'entourer l'autre et de lui faire partager ses
sentiments. Mais il y aura toujours ce déclic. Ce petit truc qui fait qu'on se
sent en sécurité juste à ce moment là et que le reste du monde semble bien
petit face Ă ce qui se passe Ă l'instant mĂȘme. Comme une dĂ©charge de bien ĂȘtre.
Se sentir partir. Loin. Tellement loin. Fermer les yeux pour mieux s'en aller.
Et ressentir les battements de son cĆur.
.
Par
Monsieur Rever.de.demain
Et c'est
ce que je fais, rĂȘver de demain, il faut bien rĂȘver Ă quelque chose. On ne sera
plus jamais dans le mĂȘme canapĂ©, je ne pourrais plus laisser ma tĂȘte tomber
contre ta nuque et te respirer. Je resterais avec ces souvenirs qui font vivre.
Il le dit bien le J-D c'est pourquoi j'ai mis son texte lĂ , j'espĂšre qu'il ne
m'en voudra pas. Oui, se réfugier dans les bras de quelqu'un c'est entrer dans
son univers, surtout quand les bras ne sont pas seulement un refuge. La berceuse
je l'ai encore en tĂȘte et le rĂȘve j'ai cru pouvoir le vivre longtemps encore.
Parfois, et c'est lĂ le cĆur du problĂšme, on se sent partir trop loin et on
quitte toute amarre. C'est parce qu'en mĂȘme temps on n'aura pas voulu sortir de
cet univers qui ne nous appartient pas. Le déclic a duré tellement longtemps...
Lorsque le son s'est enfin tût dans cette nuit que je voulais voir s'abattre
sur une autre qui me semblait jour, j'ai compris que rien ne sera plus jamais
pareil. EmmĂȘler nos cheveux, comme emmĂȘler nos doigts. Parce que moi je n'ai
pas voulu partir. Parce que moi je n'ai pas pu oublier. Parce que moi j'ai
inventé des mondes sur ce qui n'était qu'une décharge. Parce que moi je me suis
inventĂ©e une centrale nuclĂ©aire pour ne jamais ĂȘtre en manque de courant. Parce
que moi... Parce que moi... Et jamais je ne saurais te dire que c'est ta faute.
Comme si tu ne m'avais pas laissé le temps de grandir, de prendre du recul.
Alors que c'est moi, encore et toujours qui avançait, envers et contre tout.
Contre le temps, aussi. Mais c'est connu : Ă force de vouloir jouer avec
les aiguilles on finit par les casser.
Ce texte
ne devait pas finir comme ça. En fait il n'est peut-ĂȘtre pas fini. On verra
quoi.
Mardi 7 août 2007 à 17:31
Les phrases comme ces piques qu'on m'envoie sans y prĂȘter attention.
Comme si elles ne restaient pas, comme si derriĂšre il n'y avait rien
qu'un sujet, un verbe et un complément.
Il ne faut pas oublier les raisons, les anthitĂšses, les conjonctions, aussi, surtout.
"Mais, ou, et, donc,car.. " On l'apprend jusqu'Ă ne plus en connaĂźtre la signification.
Alors que parmis nous se trouvent des personnes qui, encore, s'arrĂȘtent et observent, dĂ©cryptent et s'acharnent;
Non, ces phrases ne me laissent pas : elles me hantent, comme autant de coups de pied au cul.
.. . .... ........ .... .. .... mais .. .... ... ...
A compléter, un jour.
Complétons : Je t'aime beaucoup "Mymy" tu sais mais je suis pas fou.
VoilĂ une part qui revient de droit Ă la catĂ©gorie "ça me fait chier cette folie" que vous retrouverez ici, ici, ici, ici (mĂȘme si j'avoue n'avoir toujours pas compris la fin) et ici
Ouais, c'est assez rare pour ĂȘtre soulignĂ©.
Mardi 7 août 2007 à 15:41
La bonne parole :
"Ce mec est juste le fantasme absolu de toute fille
hétérosexuelle normalement constituée."
Je n'ai qu'Ă
acquiescer
Je n'ai qu'à me réjouir durant une centaine de
jours parce qu'il m'a envoyé un SMS.
Sans que je n'ai eu Ă
l'harceler.
Ca va, ça va.
Ou comme dirait
Kiki : vous ĂȘtes grand, brun, Ă la peau mate, aux yeux noirs (marron
fonçé accepté), appelez Mymy !
Offre soumise Ă condition,
dans la limite des stocks disponibles et pouvant ĂȘtre modifiĂ©e sans
avis préalable.
Oué, avec Jul on est des serials ]céréales ? bouuuuuffe